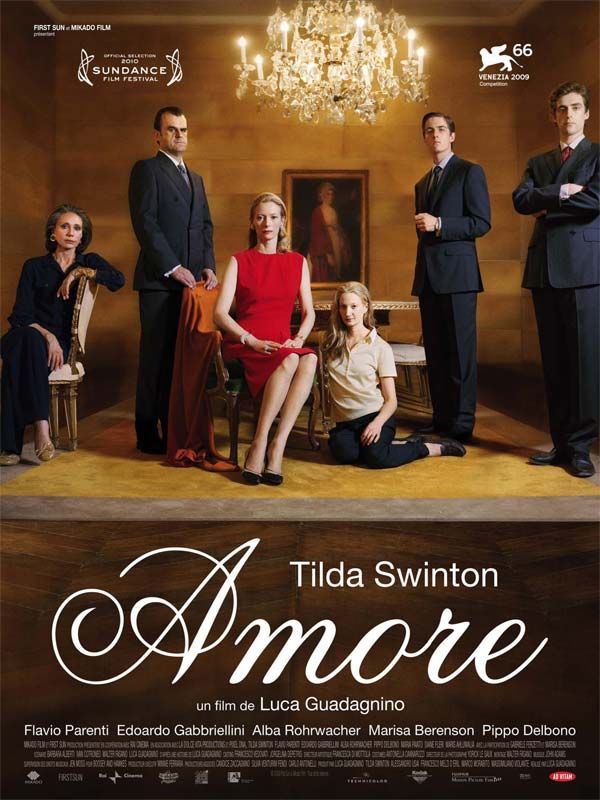3/3/2002.
Un restaurant italien. Décor chaleureux. Lumière douce. Ambiance feutrée.
Elle, élégante, cheveux sombres au carré. Bronzée, souriante.
Lui, chemise blanche sans cravate, brun, cheveux flous, l’air plutôt réservé.
H (d’une voix douce et basse) : Tu sais, ces séances de groupe, c’est vraiment précieux pour moi.
F (aimablement) : Mais comment ça se passe, au juste ?
H : C’est difficile à décrire…
F : Tu peux peut-être essayer quand même. Ca consiste en quoi ? On m’a dit que cela faisait un bien fou, mais au fond je ne sais pas de quoi il s’agit.
H (s’animant) : Eh bien, tu vois, par exemple, si j’ai vécu quelque chose de douloureux dans la journée, je vais essayer de le raconter… et, même, de le revivre… (Il leur verse du vin à tous les deux).
F (calmement) : Ca, tu peux le faire avec moi, ou avec un ami…
H : Oui, mais ce sont des choses très fines, qui sont dures à exprimer…
F : Je vois…
H : Et puis, ensuite, quelqu’un va mimer ce que j’ai raconté, enfin, jouer le rôle de l’agresseur, entre guillemets, enfin…, si c’est un épisode où il y a eu un agresseur supposé.
F : Tu peux changer les rôles ?
H : Oui, bien sûr, je peux aussi jouer l’agresseur et quelqu’un va jouer moi.
F (simplement interrogative) : C’est un genre de théâtre, alors ?
H : (Silence) …
Il a pris le verre rempli d’un vin grenat et il boit lentement. Ses yeux restent baissés. Quand il lève le regard, il s’aperçoit qu’elle le fixe avec intensité.
F (troublée par son silence) : Enfin, du théâtre dans le genre catharsis, je veux dire…
H (d’une voix douce et basse) : Tu sais, ça joue sur des émotions très fines, ça n’a rien d’hystérique. Ca me réconcilie avec mes émotions. (Il sourit avec un air de s’excuser.)
Elle fait un sort aux calamars à la tomate. Elle les découpe, les cisèle avec une mine appliquée avant de les avaler avec jubilation. Une grande lampée de lambrosco. Elle lui sourit d’un air ravi.
F : Tu es tellement sensible, c’est ce qui est adorable chez toi.
H : Mais ça ne vaut pas que pour moi, tout le monde en profite, tout le monde profite des émotions de tout le monde.
F (les yeux baissés vers son assiette, occupée à manger, conciliante) : Oui, oui, c’est bien ce que je dis, comme au théâtre.
H : (Silence)…
Il fixe son assiette, se tient parfaitement immobile.
F (sans acrimonie) : En tout cas, j’ai l’impression que tu ne peux plus t’en passer. La vraie vie, c’est ce qui se passe là-bas, dans les groupes. Les vraies émotions, c’est là-bas que tu les as. Ailleurs, la vie est fade, non ?
H (seulement légèrement impatienté, d’une voix toujours douce) : Je t’ai dit que ça n’avait rien à voir avec du théâtre, du spectaculaire. Je ne suis pas devenu un acteur, et je ne me défoule pas non plus. Ces stages, c’est toi qui m’en as parlé. C’est douloureux. Mais ça me fait évoluer. Et ça en fait évoluer d’autres que moi, en même temps que moi.
F (toujours conciliante) : Evidemment, c’est ça qui est merveilleux, le partage, en somme.
H : Tu ne crois pas, toi, qu’il est absolument nécessaire de revivre des émotions, par exemple de notre enfance, pour pouvoir les dépasser et évoluer ?
F : Si, si, bien sûr.
Elle lui sourit gentiment.
H : Je veux dire, même entre nous, ça ne peut qu’aller mieux si j’arrive peu à peu à comprendre ce qui se passe en moi.
F : Moi, je trouve que ça ne va pas si mal, entre nous. Tu le sais, rien ne vaut pour moi un vrai travail sur le comportement , sur les comportements de tous les jours, je veux dire. Si tu acceptais de mettre un peu d’ordre dans la maison, de ne plus laisser traîner slips et chaussettes sales dans la chambre, franchement, ça déjà, ce serait formidable. (Plus malicieuse qu’ironique) Tu pourrais mimer une saynète sur ce thème-là, non ?
H (très calme, très maîtrisé) : Tu ne me prends jamais au sérieux. Tu ramènes tout ce que je fais à un jeu, et un jeu puéril, en plus. Tu ne me respectes pas.
F (souriante, mais les sourcils froncés) : Tu ne crois pas que tu exagères un peu ? C’est moi qui t’ai recommandé ces séances de gestalt, ne me dis pas maintenant que je n’ai pas de respect pour ce que tu y fais.
Il se tait, la regarde brièvement, prend son verre, le contemple, boit enfin.
F (comme découragée) : Et voilà, j’ai l’impression que tu es parti pour faire la tête un bon bout de temps. Quel cinéma tu fais parfois pour rien !
H (amer pour la première fois depuis le début de la scène) : Tout à l’heure, tu parlais de théâtre, on n’en sort pas… Tu vas me dire que que c’est normal, avec ma mère en vieille actrice spécialiste des bides et ma soeur qui cachetonne depuis des années…
F (calme, mais triste) : Tu sais très bien que je n’admire rien tant que les artistes, et en particulier les comédiens.
H (véhément) : C’est faux, tu n’admires que les gens réalistes, pratiques, doués pour la vie. Je n’en suis pas.
F (suppliante) ‹ Arrête, s’il te plaît. Elle a pris sa main. Elle la caresse du regard et des doigts. Il retire sa main avec brusquerie. Ecoute, nous passions une soirée si délicieuse, il fait doux comme à Sienne l’an dernier, à la même époque. Tu te souviens ? Le repas est succulent et j’ai hâte de me retrouver dans tes bras. Arrêtons cette dispute. C’est ta fragilité qui me touche en toi, tu le sais bien.
H (calme mais persifleur) : C’est ça, je suis fragile et toi, tu es tellement solide. Les rôles sont distribués. En fait, tu es construite, artificielle, fabriquée. Tu es calme en apparence seulement, au fond tu es angoissée, très angoissée. Tu es totalement coupée de tes émotions et c’est ça qui te rend sadique.
F (plus surprise qu’indignée) : Sadique ! Tu y vas un peu fort, non ?
H : Je ne suis pas sûr.
F : Je n’ai plus faim. Et toi ? Alors, demandons la note. J’ai besoin d’une bonne nuit pour me remettre. Si j’arrive à dormir après tout ça…
H ( ironique) : Surtout qu’on s’est donné en spectacle, n’est-ce pas ? Une pseudo-scène de ménage au restaurant, quelle horreur !
F : S’il te plaît, arrête. Je ne te reconnais plus . Mademoiselle, l’addition, s’il vous plaît !