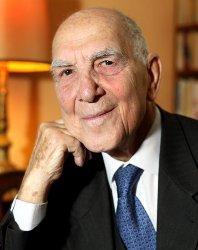“La fourmi transporte une mouche morte. La fourmi ne voit pas le chemin, elle retourne la mouche et revient sur ses pas.”
Dès les premières lignes, on a compris : le minuscule, le détail contemplé indéfiniment tiendront une place déterminante dans le récit qu’on aborde – intimidés que nous sommes de nous plonger dans le lecture d’un Prix Nobel de littérature (2009)…
Les êtres humains apparaissent peu à peu, esquissés, deux jeunes femmes dans la touffeur de l’été, couchées sur une couverture sur le toit-terrasse d’un immeuble. La fourmi, la mouche, le ver de la pomme leur disputeront le premier rôle, on le sent bien, comme la tache de vin sur le cou de l’agent de la Securitate ou le vernis ébréché sur les ongles de Clara. L’écriture de Herta Müller anime chaque présence, chaque objet d’intentions qui lui sont propres. Les choses mènent leur vie, à côté des humains et sans se soucier d’eux.
“Des dahlias poussent sous les premières rangées de fenêtres de l’immeuble, ils sont grands ouverts et leurs bords déjà en papier à cause de l’air brûlant. Ils regardent dans les cuisines et les chambres, dans les assiettes et les lits.”
Les dahlias espions, étrange image… Insensiblement, le lecteur se trouve plongé dans l’ambiance asphyxiante d’une dictature (en l’occurrence la Roumanie de Ceausescu), aussi grise et terne qu’impitoyable. Les êtres s’y traînent brisés, humiliés, dans des décors où la laideur le dispute à la misère. Face à ces fantômes, il semble presque naturel que les objets, le monde végétal se fassent loquaces, actifs.
“Un jour, Paul a regardé la forêt avec les jumelles. (…) L’immense boule d’aiguilles et de feuilles lui a fait peur. Les buissons aussi, qui poussent dans tous les sens. Leur bois, qui a compris depuis longtemps comment pousser. Car ce qui est plus sauvage chasse tout ce qui se retient avec docilité, lui coupe la lumière en haut et la terre en bas.”
J’aime beaucoup cette sorte d’aphorisme que Herta Müller sème ici ou là. Cette belle dernière phrase : “Car ce qui est plus sauvage…” m’évoque le « Un homme, ça s’empêche», forte et simple formule que l’on doit au père d’Albert Camus et que son fils reprit à son compte dans “Le Premier Homme”, son dernier roman, inachevé, brisé net par sa mort.
Plus loin, ” le cercle de la lampe de poche trébuche, (…) le stade retient son remblai dans le noir, (…) du fer bat derrière le stade, c’est là qu’est l’usine. (…) Des fenêtres sont éclairées, réveillées, et des fenêtres à côté sont noires, posées contre les murs dans leur sommeil.”
Une sombre poésie, une funèbre mélopée s’élèvent de ces pages, sans que la lumière ne puisse, semble-t-il traverser ces ténèbres, “poisseuses”, adjectif-clé chez Herta Müller.
C’est très impressionnant et très fort, rapidement oppressant avec peu de moyens, une apparente simplicité, une sobriété souvent poignante.
“Il fait sombre à la fenêtre, le peuplier est parti. L’ampoule s’y reflète, le plafond, l’armoire et le mur, les prises et la porte. Une pièce comme la moitié d’une fenêtre, accroupie et rétrécie jusqu’à n’être que du verre. Et il n’y a personne à l’intérieur.”
On n’ose le dire, mais l’ “intrigue” existe et on a bel et bien affaire à un roman – du coup difficile à lire. Comment suivre le déroulé du récit et ne pas s’abandonner au pur plaisir de l’écriture poétique? On est, comme dans le nouveau roman avec son tabou dictatorial d’absence de héros, sans humains auxquels s’accrocher. Les personnages ne manquent pas pourtant : Adina, celle dont la peau du renard – maigre tapis – sera découpée peu à peu, Anna, Clara, Pavel, Paul, Abi… On comprend qu’Adina est désirable, Clara futile, Paul et Abi engagés politiquement dans une lutte sourde contre le régime, mais ils demeurent sans chair. Chosifiés pendant que les objets sont animés d’une vie propre. Et cette “mort du personnage” alliée à la description d’une réalité sociale inhumaine rend la lecture, il faut l’avouer, parfois éprouvante.
“Une belle soirée. Dans un beau pays. On pourrait tous se pendre.” Tout est dit.